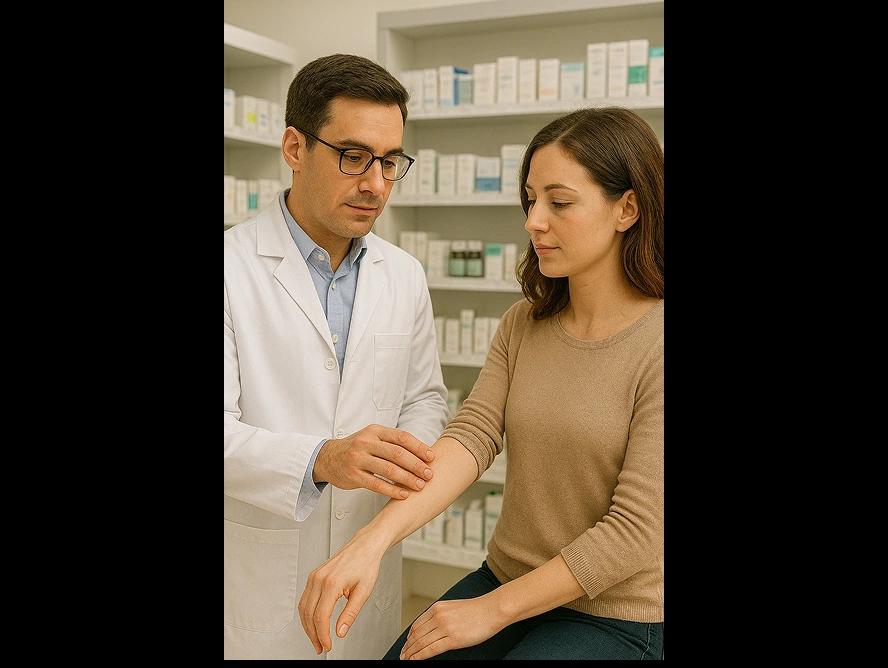Rugosité, tiraillements, démangeaisons… Lorsqu’un patient se plaint de sécheresse cutanée persistante, il est essentiel de penser à une origine iatrogène. En officine, les troubles de la peau liés aux traitements médicamenteux sont fréquents, mais souvent sous-estimés. Pourtant, la xérose (ou sécheresse cutanée) peut altérer la qualité de vie, majorer le risque d’infections et impacter l’observance thérapeutique.
Au comptoir, votre rôle est central : savoir repérer les signes d’une xérose iatrogène permet d’orienter le patient vers des solutions adaptées, et parfois de prévenir des complications. Au-delà de la xérose, d’autres atteintes cutanées médicamenteuses peuvent être rencontrées, comme la dermite séborrhéique, le syndrome main-pied ou certaines réactions lichénoïdes.
- Qu’est-ce que la xérose ?
- Les médicaments responsables de la xérose iatrogène
- Comment identifier la xérose iatrogène en officine ?
- Quels conseils pour la xérose iatrogène en officine ?
- Quand orienter vers un médecin ?
Qu’est-ce que la xérose ?
La xérose correspond à un assèchement anormal de la couche cornée de l’épiderme, entraînant une altération de la barrière cutanée. Elle se manifeste par une peau rugueuse, terne, parfois fendillée ou squameuse. Lorsque cette sécheresse est induite par un médicament, on parle de xérose iatrogène.
Cette forme particulière de xérose peut apparaître sur différentes zones du corps et s’aggraver en hiver ou dans des environnements secs. Elle s’accompagne souvent de prurit, d’érythème, voire de microfissures douloureuses.
Les médicaments responsables de la xérose iatrogène
Plusieurs classes thérapeutiques peuvent altérer l’équilibre cutané :
- Antihistaminiques : leurs effets anticholinergiques induisent une réduction des sécrétions corporelles, y compris la production de sueur, entraînant une déshydratation cutanée.
- Diurétiques : en provoquant une déplétion hydrique, ils contribuent à l’assèchement de la peau et réduisent l’activité des glandes sébacées.
- Isotrétinoïne : souvent utilisée contre l’acné sévère, elle est bien connue pour ses effets asséchants sur la peau et les muqueuses.
- Antipsychotiques et antidépresseurs : certains, via leurs effets anticholinergiques, provoquent également une sécheresse importante.
- Antihypertenseurs : en modulant la fonction des glandes sudoripares ou sébacées, ils peuvent indirectement favoriser la xérose.
Il ne faut pas oublier la xérose induite par la radiothérapie, fréquente en oncologie, qui nécessite une prise en charge locale spécifique.
Comment identifier la xérose iatrogène en officine ??
Quels sont les signes cliniques chez les patients ?
En tant que professionnel de santé de proximité, vous êtes souvent le premier interlocuteur en cas de gêne cutanée. Les signes cliniques sont généralement les suivants :
- Peau sèche, rugueuse, qui desquame.
- Démangeaisons, sensation de tiraillement.
- Parfois, zones érythémateuses ou fissurées.
L’interrogatoire orientera votre conseil :
- Quels sont les traitements en cours ?
- La gêne est-elle apparue après l’introduction d’un nouveau médicament ?
- Y a-t-il des facteurs aggravants comme l’hiver, l’utilisation de savons agressifs ou une hydratation insuffisante ?
Il est important de différencier ces symptômes d’une dermatose chronique (eczéma, psoriasis…), dont la prise en charge relève d’un avis médical. Le contexte iatrogène, notamment chez un patient récemment polymédiqué, peut vous orienter. Pour en savoir le plus sur la xérose, une formation à la Dermatologie peut vous aider lorsque vous dispensez vos conseils.
Quels sont les facteurs de risque associés ?
Certains profils de patients sont particulièrement exposés :
Personnes âgées ou polymédiquées : la xérose est plus fréquente en lien avec le vieillissement cutané et la multiplicité des traitements.
Patients à terrain atopique : une peau atopique, qui se caractérise déjà par une sécheresse cutanée importante, est plus vulnérable face aux effets déshydratants des médicaments.
Patients sous traitement oncologique ou psychiatrique : souvent confrontés à des effets secondaires cutanés, ils nécessitent un accompagnement renforcé.
Quels conseils pour la xérose iatrogène en officine ?
Une fois la xérose identifiée, le conseil pharmaceutique permet d’améliorer le confort du patient, de prévenir une aggravation, voire un défaut d’observance.
Hygiène et mode de vie
Recommandez des produits lavants ultradoux, surgras, sans savon.
Encouragez le port de vêtements doux, en coton, et la protection contre le froid et le vent.
Sensibilisez à une hydratation orale suffisante.
Alimentation
Conseillez une alimentation riche en acides gras essentiels (oméga-3, oméga-6).
Certains compléments à base d’huile de bourrache ou d’onagre peuvent soutenir l’hydratation cutanée, en s’assurant de l’absence de contre-indications ou d’interactions médicamenteuses avec les traitements en cours.
Soins dermocosmétiques
Préférez des émollients riches, à base de beurre de karité, glycérine, urée ou huiles végétales.
Orientez vers des formules sans parfum, sans alcool, bien tolérées par les peaux fragilisées.
Encouragez une application quotidienne, voire biquotidienne, sur peau propre et légèrement humide.
Plantes et huiles essentielles
Certaines HE (comme la lavande vraie ou le bois de rose) peuvent apaiser les démangeaisons, à condition d’être très diluées et utilisées en l’absence de contre-indications.
L’huile végétale de calendula, ou de bourrache, offre un bon support apaisant.
La camomille, en infusion ou lotion, peut aussi être proposée en soutien.
Quand orienter vers un médecin ?
Si la xérose devient très étendue, douloureuse ou résiste aux soins locaux, un avis médical est indispensable. Il peut être nécessaire d’ajuster le traitement en cause, de prescrire un émollient spécifique, voire d’écarter une autre pathologie dermatologique sous-jacente. Il est essentiel d’orienter si la xérose est susceptible d’impacter l’observance du traitement.
La xérose iatrogène est un effet secondaire fréquent, mais souvent évitable ou contrôlable grâce à un bon repérage et un accompagnement adapté en pharmacie. Votre vigilance, votre écoute et votre capacité à proposer une prise en charge personnalisée sont des atouts majeurs pour améliorer la qualité de vie des patients.
Cet article a été validé par des professionnels de santé et vérifié par des sources sûres au moment de sa publication. Il ne prétend cependant pas à l’exhaustivité des informations fournies. Le présent article n’a qu’un but informatif et ne remplace pas une formation ou un conseil médical.